La France perd la mémoire — Comment un pays démissionne de son histoire, Jean-Pierre Rioux, Perrin, 2006, 223 p.
Par AG le mardi 21 juin 2011, 08:03 - Nous avons lu - Lien permanent
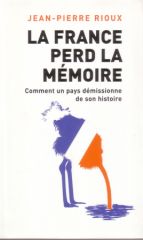 Le livre de Jean-Pierre Rioux que nous présentons ici n’est
pas à dire le vrai un ouvrage d’histoire, mais plutôt un essai, voire un essai
polémique, abordant des thèmes sensibles : le devoir de mémoire, la
repentance, la sauvegarde du patrimoine local, la mémoire nationale, l’enseignement
de l’histoire.
Le livre de Jean-Pierre Rioux que nous présentons ici n’est
pas à dire le vrai un ouvrage d’histoire, mais plutôt un essai, voire un essai
polémique, abordant des thèmes sensibles : le devoir de mémoire, la
repentance, la sauvegarde du patrimoine local, la mémoire nationale, l’enseignement
de l’histoire.
Il faudrait citer de nombreux passages de cet ouvrage
décapant, nous avons choisi les deux longues citations suivantes qui donnent le
ton de ce livre :
« [p. 118] Il faudra bien écrire un jour l’histoire de
ce terme qui, prenant forme au vu de l’horreur des camps de la Seconde Guerre
mondiale, a glissé des rescapés à tous les témoins, via leurs associations,
puis a irrigué au fil des ans le dispositif médiatique, judiciaire et même
civique, jusqu’à être tenu paresseusement non seule¬ment pour l’élément moteur
d’une mémoire collective mais aussi pour une « nouvelle religion civique »
(Georges Bensoussan).
Ce souci n’est certes pas nouveau. Dès après 1945, les
premières Amicales de déportés ont voulu à la fois honorer la mémoire des
disparus, maintenir présents dans l’esprit des Français les actes de barbarie
dont ceux-ci avaient été les victimes et plaider, en termes de militance, pour
empêcher tout retour de cette barbarie-là. Après quelques troubles aux heures
chaudes de la guerre froide, depuis les années 1960 qui ont vu la création du
Concours de la Résistance en 1961, lequel s’ouvrira en 1972 à la Déportation,
ce réseau du souvenir a tenu à signaler aux jeunes générations l’urgence d’un
combat pour l’« impossible oubli ». A cette époque, l’histoire du second
conflit mondial était inscrit dans les programmes des classes terminales et se
souvenir passait d’abord, de l’avis général, par la connaissance, qui seule
permettait de ne pas laisser retomber l’opinion dans la xénophobie et le
racisme par ignorance. C’est alors que la formation des enseignants est devenue
une préoccupation première et un enjeu stratégique, via notamment l’Association
des professeurs d’histoire et de géographie. Les pouvoirs publics et les
autorités de l’Education nationale enfin entérinaient et relayaient maintes
initiatives qui toutes voulaient enseigner à la fois par la connaissance
historique et par le rapport direct des jeunes élèves avec les survivants et
les combattants. »
« [p. 171] Car le monde actuel affaiblit la nation et
valorise les métissages, les appartenances multiples ; il redécouvre les
diasporas historiques, notamment l’arménienne, la juive ou la tzigane, prône la
pluralité et la flexibilité migratoire ; il démultiplie l’appartenance. Plus
personne n’ose s’identifier au mieux-être, au « heureux comme Dieu en France »
qui mouvait et émouvait tant de migrants jadis. Si bien que se faire rendre
justice et obtenir réparation, dénier et effacer le Mal au nom du droit et de
la morale est devenu l’impératif présent qui mobilise le sujet et le lance dans
d’inquiètes et incessantes vérifications d’identité. Voilà pourquoi, on l’a vu,
les immigrés, les migrants, les ex-colonisés posent aujourd’hui tant question à
la mémoire nationale.
Dans ces conditions, les « politiques de l’identité »
pourraient un jour assigner tout individu, tout groupe humain, tout peuple à
son origine et non plus à une mémoire collective partagée et sécularisée, le
faire entrer dans un cycle de violence civile et d’exclusion sociale puis
raciale, voire religieuse, au nom de l’atavisme. Du coup, quelques-uns,
exaspérés et désespérés par notre « présentisme », conscients de la profondeur
de la crise culturelle et civique qui nous affaiblit, cherchent et trouvent
dans leur religion, l’islam, des signes de rassemblement et d’appartenance, un
code moral, spirituel et même, croient-ils, l’identité-souche, indissolublement
originelle et vraie, la seule qui vaille.
Aucun désarmement n’est en vue, quand tant de victimes
réelles ou supposées de tragédies passées ne demandent plus le seul respect de
leur malheur mais la reconnaissance d’Etat d’une souffrance qui les atteindrait
à perpétuité. »
Voir aussi Olivier Lalieu, « L’invention du devoir de mémoire », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 69, janvier-mars 2001.
Un site internet à consulter :
http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_histoire/05historiens1.htm
